conversation
conversation
DAMARICE AMAO
Docteure en histoire de l’art, historienne de la photographie, attachée de conservation au cabinet de la photographie au Musée national d’art moderne du Centre Pompidou et commissaire d'expositions.
Nous nous sommes retrouvés dans son bureau où nous avons parlé des expositions pensées comme des mises en récits, d'archives et de transmissions, de "La Subversion des images" et de "La Parenthèse surréaliste", de Charlotte Perriand, Dora Maar, des outsiders et de photo-montages. Entre autres…



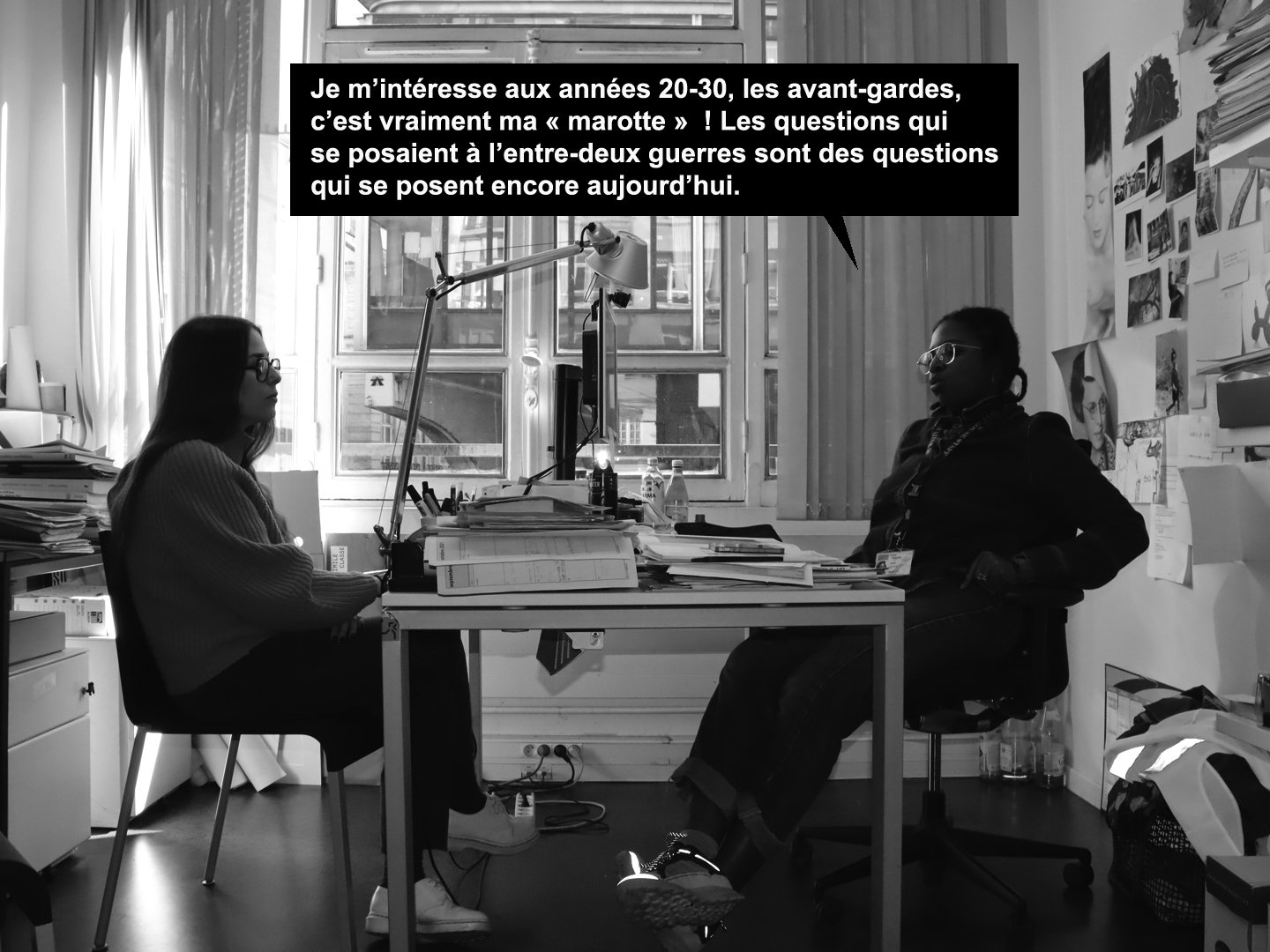








Lia : Peux-tu me raconter ton parcours ?
Damarice : J’ai un parcours classique, des années de fac après une année de prépa littéraire. Je suis un pur produit de la Sorbonne, Paris 4 ! J’ai fait une thèse en histoire de l’art et me suis spécialisée en histoire de la photographie.
Lia : Si je ne me trompe pas, ton sujet de thèse était sur Eli Lotar ?
Damarice : Exactement. À l’occasion des 40 ans du Centre, en 2017, on a fait une exposition au Jeu de Paume. C’était l’occasion de voir mes recherches universitaires valorisées à travers une exposition. Ça représente bien mon profil dans le sens où j’ai un très grand attachement à la recherche, j’ai toujours un pied à la fac où je donne quelques cours en histoire de la photographie et je vais reprendre prochainement un cycle de cours à l’école de photographies d’Arles. J’aime vraiment enseigner, toujours avec cette idée de partage avec un plus grand nombre et de parler à des publics différents. Avec mon travail au musée, j’aime beaucoup l’idée d’avoir à trouver des modalités diverses de valorisation de la collection et de nos objets de recherches sur la photographie et son histoire, que ce soit à travers le livres ou la forme de l’exposition. Trouver d’autres modes de mise en récit pour ne pas rester figée dans un cercle d’initiés.
Lia : En tant qu’historienne de l’art, tu explores le passé. Qu’est-ce qui t’a amené sur cette voie ?
Damarice : Je suis de nature curieuse. J’ai un intérêt pour l’histoire en général, pour les héritages du passé, la transmission des formes et des gestes et surtout pour la manière dont s’écrit l’histoire, ses mises en récits et toutes les problématiques que cela pose notamment dans le champ de l’histoire de l’art.
Lia : Je me souviens de l’exposition sur Dora Maar à Beaubourg et l’été dernier l’exposition sur les photomontages de Charlotte Perriand durant les rencontres d’Arles dont tu étais commissaire d'expositions. Lotar, Maar, Perriand : On peut dénoter un certain intérêt autour du surréalisme ?
Damarice : Oui, c’est vrai. J’ai commencé dans la recherche par la période de l’entre-deux-guerres, les fameuses années 20-30. Une période que j’ai découverte grâce à mes études en histoire de l’art. Au moment où je devais réfléchir à un sujet de master pour mon mémoire, un professeur m’a proposée de travailler sur le surréalisme en Belgique. René Magritte, Paul Nougé, Marcel Mariën … Parallèlement à mes recherches, j’ai fait un stage au cabinet de la photographie. C’était au moment de la préparation de l’exposition sur la subversion des images, abordant les relations du surréalisme à la photographie et au cinéma. Mes recherches sur la photographie et le surréalisme en Belgique, comme d’autres études au même moment constituaient un moyen de contribuer modestement au développement d’autres perspectives d’études sur le sujet. Pendant mon stage au cabinet photo, j’ai passé des mois à dépouiller des revues de l’entre-deux-guerres, ça été très formateur. Aujourd’hui, alors que je travaille au cabinet photo, j’utilise encore ces recherches faites dans les revues lors de ce premier stage. Tout s’est mis en place depuis le début, finalement.
Lia : J’ai l’impression qu’à travers ton approche de l’histoire, tu cherches à mettre en lumière des aspects cachés, ignorés par le grand public ?
Damarice : Je cherche à poser un nouveau regard sur les choses. Pour moi, il faut avoir des choses à dire ou du moins, des choses nouvelles à dire. Après, ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas s’attaquer à des choses, des figures que l’on connaît déjà mais il faut essayer de les aborder selon de nouvelles perspectives, de nouvelles sources.
Lia : Bien sûr, il y aura toujours divers points de vue. C'est ce qui est passionnant.
Damarice : Ce qui m’intéresse, ce sont les outsiders, ceux qui rentrent difficilement dans l’histoire. Le rapport entre la photographie et le surréalisme, c’est une construction d’abord discursive et théorique, qui émerge dans les années 70 quand des gens comme Rosalind Krauss, Dawn Ades ont commencé à le constituer comme un champ d’étude. Ce n’était pas forcément un champ admis par l’histoire classique de la photographie. J’aime bien voir comment l’histoire, le discours interroge ce qui est ou ce qui n’est pas ou ce qui peut potentiellement rentrer dans l’histoire de la photographie ou l’histoire de l’art. Donc oui, je m’intéresse beaucoup aux personnes qui sont dans l’entre-deux, en marge comme le surréaliste Jacques-André Boiffard.
Lia : L’exposition qui lui était dédiée au Centre Pompidou avait pour titre « La parenthèse surréaliste » comme pour souligner la notion d’entre-deux à laquelle tu as fait allusion.
Damarice : En effet, ce sont des parcours intéressants qui apportent un autre regard sur la pratique de la photographie. Les gens qui aiment le surréalisme le connaissent même s’il n’a pas fait carrière comme Man Ray ou Cartier-Bresson. Il a d’ailleurs interrompu sa carrière de photographe assez rapidement tout comme Eli Lotar.
Lia : À propos de Dora Maar, il y a eu la rétrospective au Centre Pompidou ou encore le livre de Brigitte Benkemoun « Je suis le carnet de Dora Maar » sortie la même année. C’est étonnant de constater comme certains sujets peuvent ressurgir simultanément.
Damrice : Dora Maar fait l’objet d’une attention dans le champ des études surréalistes depuis plusieurs décennies déjà. Et sa relation avec Picasso l’a fait entrer dans la légende sans pour autant que son travail de photographe soit si bien connu du grand public. L’objet de l’exposition au Centre avec ma collègue Karolina Lewandowska était de restituer son travail photographique de manière précise et de mettre en lumière des aspects de son travail photographique souvent négligé. Par exemple, on peut se demander si certaines de ces photographies plus commerciales ont leur place au musée ? Mais nous avons fait le choix délibéré d’ouvrir l’exposition sur son travail de commande. C’est un choix. En histoire de l’art, il ne s’agit pas seulement, d’entériner des classifications, des modes de récit mais de se dire aussi « et pourquoi pas ? » mettre en lumière , tel ou tel aspect . Je crois que c’est vraiment cet effort discursif qui me plait.
Lia : Ce point que tu soulèves autour de la légitimité d’une œuvre selon certains contextes s’applique encore aujourd’hui. Il y a toujours eu des artistes qui ont jonglé entre les commandes (institutionnelles, commerciales) et les expositions. Souvent motivé par des nécessités financières d’ailleurs. Actuellement, la question de légitimité se pose toujours, d’autant plus avec le nombre croissant de dit « artistes » sur les réseaux, la diversité de moyens de diffusion et les marques qui cherchent du contenu. Ce n’est pas toujours évident de faire la part des choses, entre œuvres et créations de contenu. Mais bon, c’est un autre débat.
Damarice : C’est intéressant ce que tu dis par rapport à la situation actuelle. Moi, je m’intéresse aux années 20-30, les avant-gardes, c’est vraiment ma « marotte » ! Les questions qui se posaient à l’entre-deux-guerres sont des questions qui se posent encore aujourd’hui. Politiquement, socialement, on peut le voir comme un laboratoire. Connaître cette période aide à mieux comprendre le présent, à mon sens. Par exemple, l’exposition dont j’ai assuré le commissariat « Photographie, arme de classe », a eu lieu au moment des gilets jaunes – ce qui a permis de mettre en avant de nombreux enjeux communs. Il y a eu beaucoup d’attention autour des questions que pouvaient se poser les artistes. Comment l’image peut-elle être engagée ? Suffit-il simplement d’être engagé pour que ce qui est produit soit politique ? Est-ce qu’il faut produire un art qui affronte plus explicitement les questions sociales ? Ce sont des questions qu’Aragon se pose, que l’association des artistes et écrivains révolutionnaires se posait déjà à l’époque… Finalement, aujourd’hui qu’elle est le rôle de l’artiste au sein de la société dans des contextes de tensions politiques, sociales et même écologiques, telles que nous les vivons ? Connaître les expériences du passé, me permet de mieux m’ancrer dans le présent.
Lia : Bien sûr, la lumière du passé permet d’éclairer le présent. Je suis aussi très sensible à l’histoire du XXe siècle, à certains courants artistiques qui se révèlent être des outils de réflexion sur des sujets actuels. D’ailleurs, j’ai l’impression qu’on ne voit pas vraiment surgir de nouveaux courants artistiques et littéraires comme c’était le cas avec le dadaïsme, le surréalisme, la figuration libre, fluxus, l’existentialisme, l’oulipo et j’en passe. Le passé demeure une source d’inspiration, un socle. Aujourd’hui, on a cette liberté de pouvoir piocher des éléments au sein de divers courants pour appuyer nos démarches artistiques tout en vivant pleinement notre époque sans pour autant appartenir à un courant ou cercle.
Damarice : Entre la citation, le revival, la reprise, le pastiche… De nombreux questionnements traversent l’histoire de l’art et abordent le rapport à l’héritage artistique. En tant qu’historienne de l’art, la question de l’héritage est importante. Et dans tous mes projets, je pense que je questionne cet aspect.
Lia : Oui, d’ailleurs il s’agit d’une mémoire collective qui n’est pas toujours intégrée de façon consciente.
Damarice : Tu vois par exemple, « Photographie, arme de classe », est un projet qui traite des actions de la gauche radicale durant l’entre-deux guerres, dans le champ photographique. Faire une expo, ce n’est pas un geste militant en soit mais dire et montrer que ces expériences, réflexions ont existé et qu’il y a des gens qui ont voulu faire culture autour et grâce à la photographie et que ça été occulté durant des années, c’est important de le montrer. Questionner les héritages, comment on les fait émerger, comment on les occulte, comment ils empruntent d’autres terrains. C’est pour ça que je m’intéresse beaucoup à cette période, aux personnes en marges.
Lia : Des courants ou/et des personnes qui ont fait bougé des lignes ?
Damarice : Ce n’est pas forcément l’audience ou l’efficacité qui m’intéressent. Il y a des personnes et des courants qui avaient une faible audience mais qui ont existé, travaillé dans leur coin. Et ce n’est pas parce qu’ils avaient peu d’audience qu’il ne faut pas en parler.
Lia : En effet, je ne pense pas non plus que ce soit quantifiable en terme de réceptivité, un peu comme les "like", il ne faut pas s'y fier (rires) ! Certains parcours étaient si singuliers qu’ils ont le mérite d’être encore étudié et c’est précisément le travail et l’intérêt des historien.ne.s de les refaire surgir.
Damarice : Sans oublier les artistes ou toute autre catégorie de personnes, d’amateurs qui ont pu faire l’effort d’assurer la transmission d’héritages et de parcours singuliers même isolé.
Lia : Les archives, les collections sont une base pour la transmission. Même si parfois ça peut prendre des années et des années avant que cela ne remonte à la surface. Il doit y avoir tellement d’archives dont on ne soupçonne pas l’existence aujourd’hui et qui vont sans doute surgir un jour !
Damarice : Oui, ça me fait penser aux archives ayant servi aux photomontages de Charlotte Perriand. Il y a eu une première exposition sur ces photomontages au début des années 2010 au musée Nicéphore Niepce Chalon-sur-Saône mais c’était déjà plus de 60 ans après que Charlotte Perriand les avaient réalisée dans les années 1930 ! Il y a eu des décennies qui se sont écoulées avant que ce ne soit ré-exposé et que cela fasse sens encore aujourd’hui pour de nouvelles générations.
Lia : On ne comprend pas toujours certaines temporalités... Je rebondis et en profite pour te demander quelle est la différence entre photo-montage et collage ?
Damarice : Du point de vue du musée, de la conservation, la distinction est plutôt technique. Si je ne me trompe pas, avec le photocollage ou le collage à la Dada, les divers morceaux qui composent le collage sont bien visibles, la différence de textures est complètement assumée. Sur la même surface peuvent être collé des éléments hétéroclites – photo, gravures, images imprimées. Avec le photomontage, il y a une étape intermédiaire, où l’on photographie et retouche pour lisser la surface. Tu ne vois pas l’effet couture.
Lia : Donc un photomontage pourrait être un tirage d’après collage ?
Damarice : Oui, c’est ça. Comme chez Dora Maar. Pour nous, de manière pratique, le collage se distingue du photomontage en laissant apparaître la matérialité ainsi que les moyens et la gestualité : l’effet du tube de colle et les coups de ciseaux.
à découvrir
à découvrir



