conversation
conversation
MAX DE PAZ
Ecrivain
Premier roman de Max de Paz édité par Gallimard NRF, "“La manche” est un récit qui secoue, remue et nous met face à une réalité que l’on n’ose pas toujours regarder en face. À travers une narration fictive rédigée à la première personne, Max de Paz nous livre un témoignage essentiel autour de la pauvreté, de la mendicité.
Comme tous les mercredis, ma mère regardait religieusement La Grande Librairie quand Max de Paz figurait parmi les invités. Le lendemain autour d’un café, elle m’a fait son compte rendu de l’émission, particulièrement émue par ce jeune écrivain de 22 ans. J’avais alors regardé le replay de l’émission et spontanément, j’ai décidé de lui proposer un entretien qu’il a accepté avec enthousiasme. J’en étais honorée.
Nous nous sommes retrouvés dans le 5eme arrondissement, assis sur un banc aux Arènes de Lutèce, nous avons évoqué son parcours, sa vision de la pauvreté, le sentiment de honte, les problèmes liés aux addictions en invoquant Patrick Declerck ou encore Deleuze.
Entre autres.

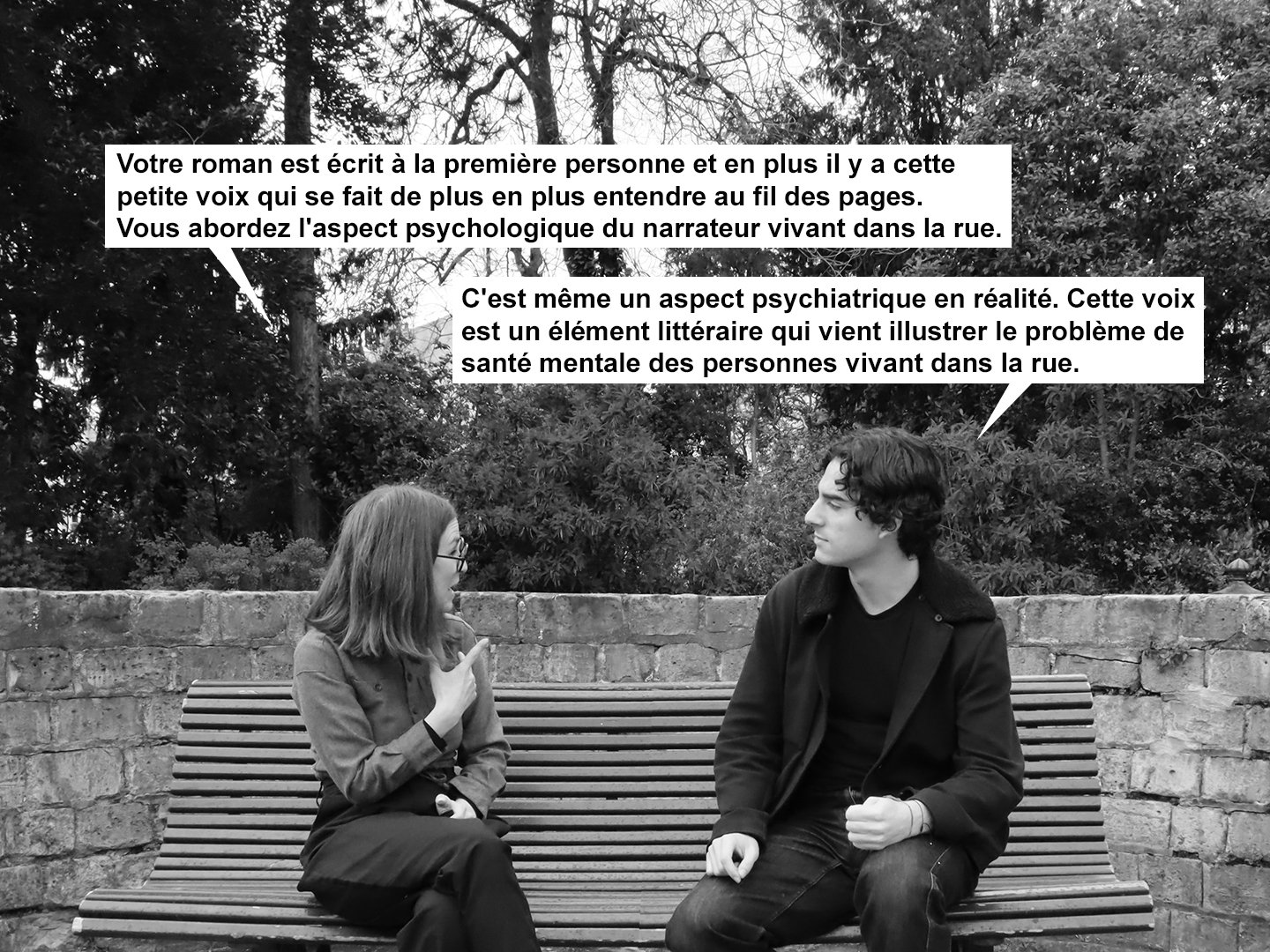

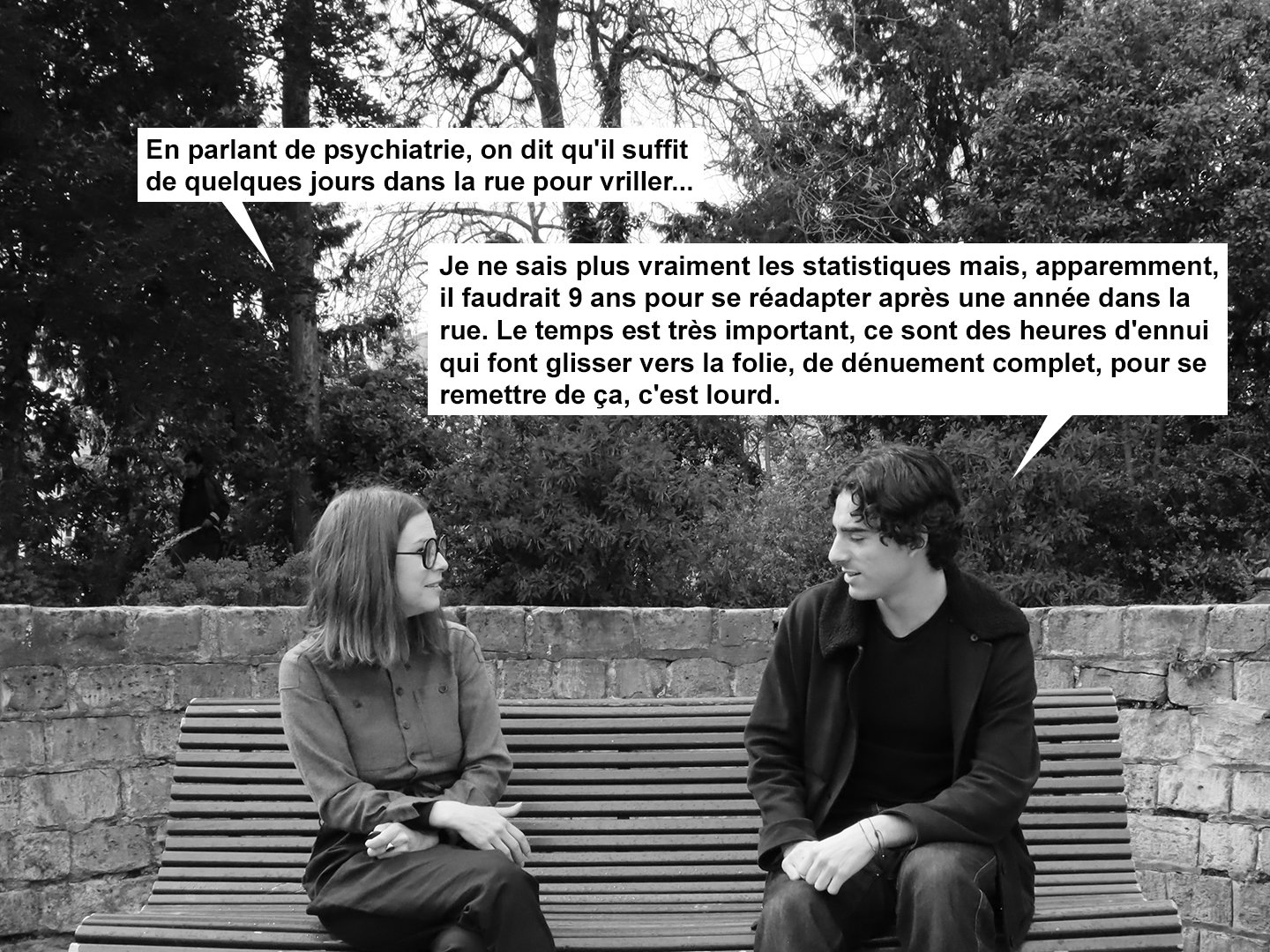
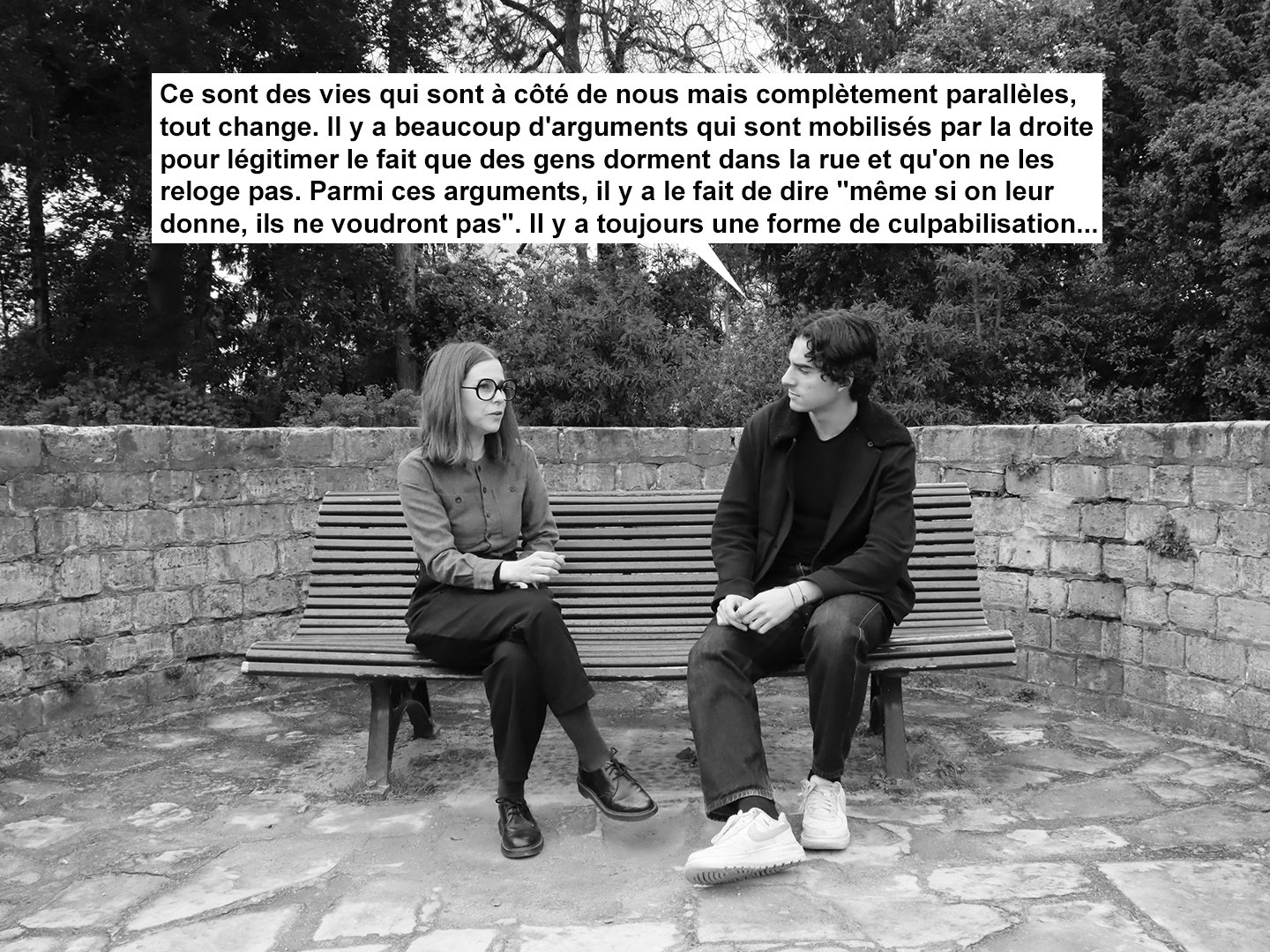
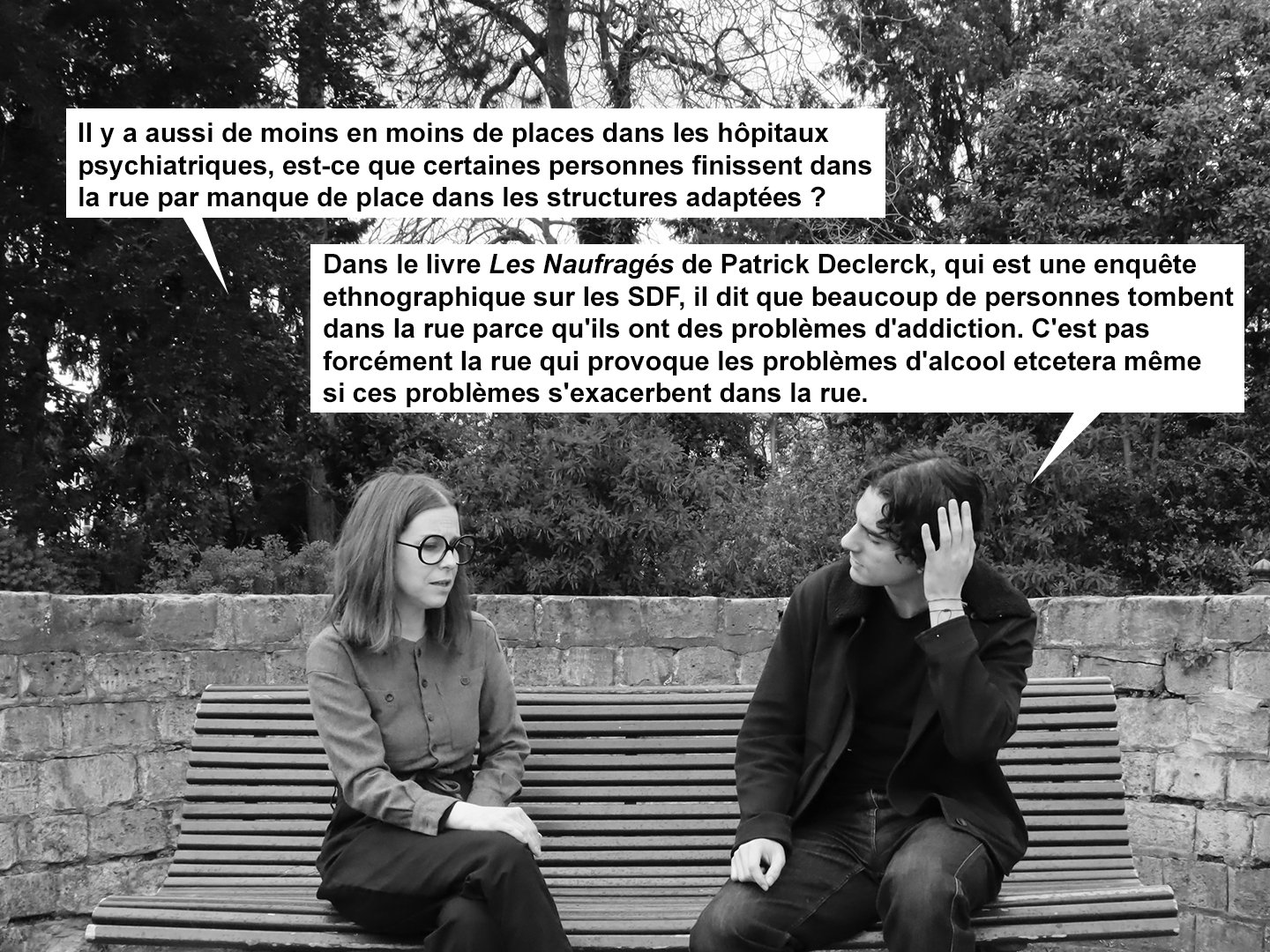

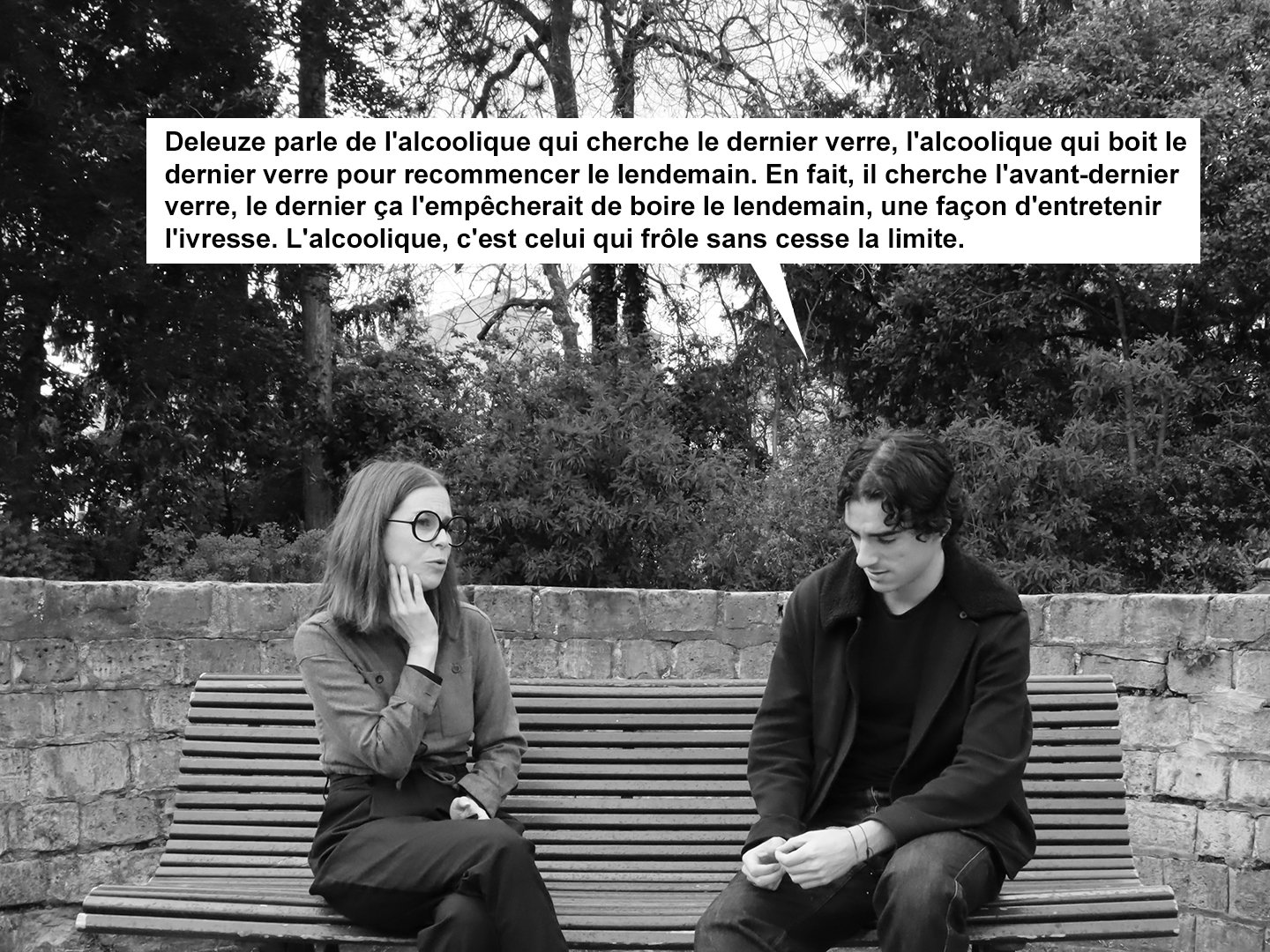
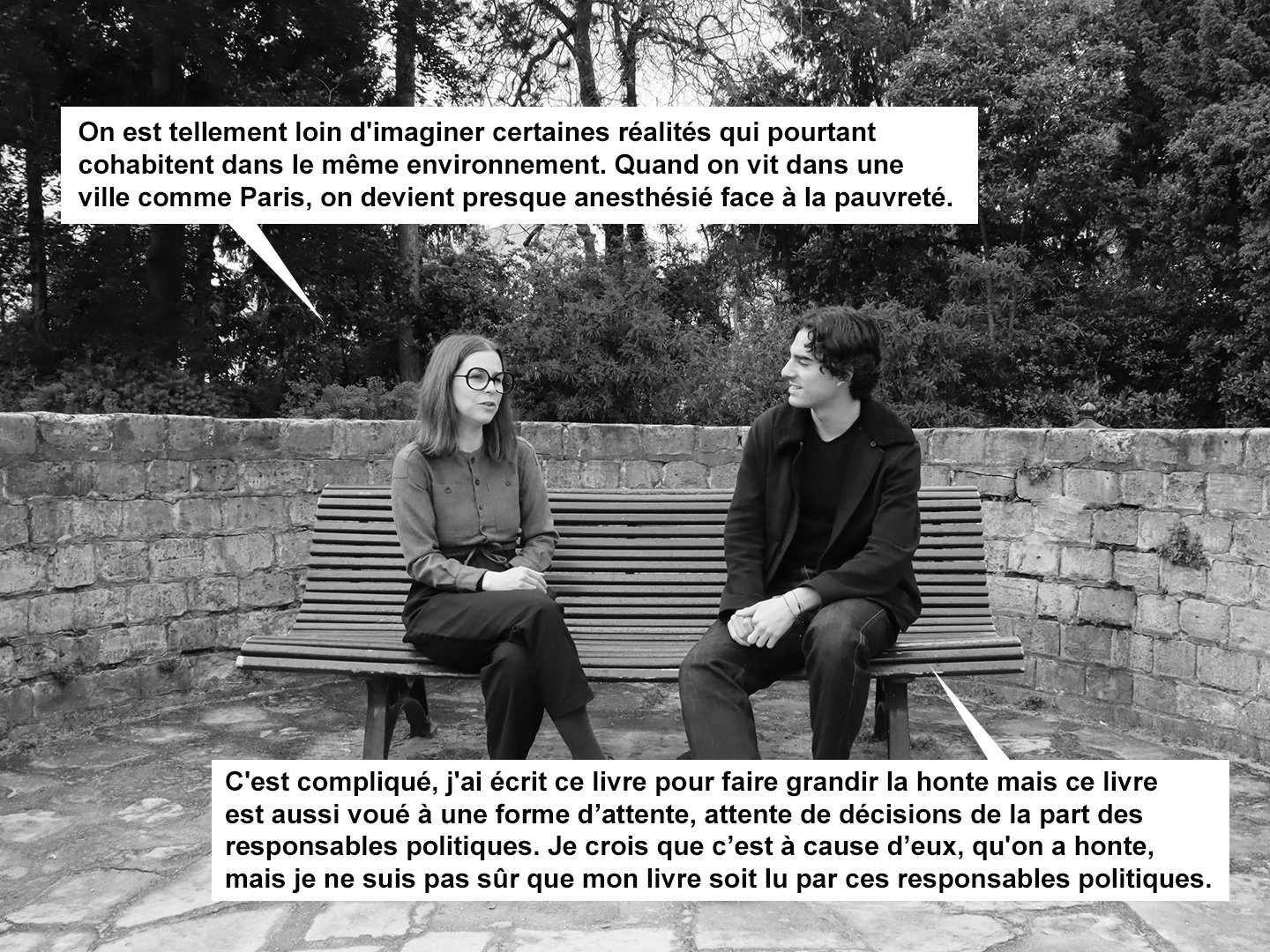
Lia : Vous avez 22 ans et, pendant le confinement, vous étiez en pleine adolescence. Comment avez-vous vécu cette période ?
Max : J'avais 17-18 ans, j'étais en prépa, donc ça n'a rien changé à mon enfermement.
Lia : Même pour se projeter dans l'avenir ?
Max : Je ne me sens pas du tout impacté par ce qui s'est passé. Je savais où j'allais, je ne peux pas me plaindre. Je n'ai pas été confronté à toutes les difficultés auxquelles ont été confrontés beaucoup de jeunes. Comme j'étais en prépa, j'étais enfermé pour travailler le concours, ça m'arrangeait même de ne pas voir les autres s'amuser (rires).
Lia : Qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion pour écrire votre premier roman, La manche ?
Max : C'est le contact de plus en plus fréquent avec des personnes sans-abris, des mendiants. Il y a toute une série de causes, je ne sais pas si le covid en fait partie mais c'est un appauvrissement général lié à des décisions politiques qui vont à l'encontre des plus pauvres en France, depuis de nombreuses années et encore plus sous ce gouvernement-là.
Lia : Votre roman est écrit à la première personne et en plus il y a cette petite voix qui se fait de plus en plus entendre au fil des pages. Vous abordez l'aspect psychologique du narrateur vivant dans la rue.
Max : C'est même un aspect psychiatrique en réalité. Cette voix est un élément littéraire qui vient illustrer le problème de santé mentale des personnes vivant dans la rue. Durant ma première année à l'ENS, j'ai fait un stage dans un hôpital psychiatrique, il y avait beaucoup de personnes sans-abris, les troubles de santé mentale, c'est un fait. La petite voix dans mon livre, elle a aussi une fonction littéraire et politique. Ce dédoublement, cette petite voix, c'est la voix qui pique pour pousser à la révolte, au sursaut.
Lia : En parlant de psychiatrie, on dit qu'il suffit seulement de quelques jours dans la rue pour vriller.
Max : Je ne sais plus vraiment les statistiques mais apparemment il faudrait 9 ans pour se réadapter après une année dans la rue. Le temps est très important, ce sont des heures d'ennui qui font glisser vers la folie, de dénuement complet, pour se remettre de ça, c'est lourd. Ce sont des vies qui sont à côté de nous mais complètement parallèles, tout change. Il y a beaucoup d'arguments qui sont mobilisés par la droite pour légitimer le fait que des gens dorment dans la rue et qu'on ne les reloge pas. Parmi ces arguments, il y a le fait de dire "même si on leur donne, ils ne voudront pas". Il y a toujours une forme de culpabilisation...
Lia : Les hôpitaux psychiatriques sont saturés, est-ce que certaines personnes finissent dans la rue par manque de place dans les structures adaptées ?
Max : Il y a un problème de moyens dans les hôpitaux psychiatriques. Dans le livre Les Naufragés de Patrick Declerck, qui est une enquête ethnographique sur les SDF, il dit que beaucoup de personnes tombent dans la rue parce qu'ils ont des problèmes d'addiction. C'est pas forcément la rue qui provoque les problèmes d'alcool etcetera même si ces problèmes s'exacerbent dans la rue.
Lia : Dans votre ouvrage, vous abordez l'addiction à travers Jonas, le frère du narrateur. Au début le narrateur s'amuse de l'ivresse de son frère, jusqu'à ce Jonas tombe violemment dans le crack.
Max : Je n'ai pas voulu faire un livre hygiéniste ou moralisateur. Tout est une question de limite. Je ne sais pas si vous voyez l'Abécédaire de Deleuze ?
Lia: Bien sûr ! Je l'ai même en DVD (ça y est je me sens de la vieille école en parlant de DVD)
Max : Deleuze parle de l'alcoolique qui cherche le dernier verre, l'alcoolique qui boit le dernier verre pour recommencer le lendemain. En fait, il cherche l'avant-dernier verre, le dernier ça l'empêcherait de boire le lendemain, une façon d'entretenir l'ivresse. L'alcoolique, c'est celui qui frôle sans cesse la limite.
Lia : Comment êtes-vous arrivé à délivrer une réalité parallèle avec tant de justesse ? Vous avez été en contact avec des sans-abris ?
Max : Oui mais pas du tout avec ma casquette d'élève sociologue ou écrivain. J'ai rencontré ces personnes en tant que passant, le groupe adversaire, concurrent à celui des mendiants. Et dans ce rapport-là, j'ai eu de très longues discussions, j'ai passé des heures à attendre le samu social avec des personnes, tout ça m'est revenu très facilement au moment d'écrire sans jamais avoir pris de notes. Ce sont des rapports qui ne peuvent pas être symétriques, il y a une très grande violence dans ces rapports. Il ne peut pas y avoir d'amitié, de relations saines. Ce sont des rapports éphémères, les sans-abris sont voués à changer d'espace, à être virés par la police, certains meurent...
Lia : On est tellement loin d'imaginer certaines réalités... qui pourtant cohabitent dans le même environnement. Quand on vit dans une ville à Paris, on devient presque anesthésié face à la pauvreté.
Max : C'est compliqué, j'ai écrit ce livre pour faire grandir la honte mais ce livre est aussi voué à une forme d’attente, attente de de décisions de la part des responsables politiques. Je crois que c’est à cause d’eux, qu'on a honte, mais je ne suis pas sûr que mon livre soit lu par ces responsables politiques. Il y a des possibilités pour réquisitionner des logements vides et des études ont montré qu'avec 1% du PIB on pourrait supprimer la grande pauvreté. Donc des choix politiques sont en cause. La fin de mon livre reste en suspens, cette fin n'est pas prescriptive de ce que devrait être le mouvement social, ce n'est pas mon rôle en tant qu'écrivain. Je ne sais pas si la littérature peut changer les choses. C'est une question que je me pose. J'ai voulu questionner ce pouvoir-là à travers le personnage d'Elise qui suscite quelque chose chez le narrateur qui ressent alors un besoin d'action.
Lia : Le personnage d'Elise m'a énormément touchée, sous une carapace, on découvre sa poésie. Le processus poétique permet des échappées et des questionnements.
Max : Il y a un pouvoir poétique dans les textes d'Élise. C'est toujours compliqué, la place de la littérature dans les transformations politiques. Quand j'étais encore un peu plus jeune, je croyais beaucoup à ce que Bourdieu appelait "l'effet de théorie", quand l'écriture vient produire des transformations dans le réel. Par exemple, quand Marx essaye de transformer "la classe en soi" en une "classe pour soi". La classe en soi c'est la classe qui a des intérêts communs mais qui n'en a pas conscience et la "classe pour soi", c'est la classe qui a des intérêts communs mais qui en a conscience et donc mobilise une action collective. Dans mon texte, il y a un groupe de mendiants et mon narrateur rêve de ça, il rêve d'un groupe qui soit soudé "avec Elise et Tamas en tête de cortège". Mais c'est peut-être une déformation de la réalité car entre SDF, il y a beaucoup de violence. Mais il y a quand même des logiques de solidarité et j'ai essayé d'imaginer cela, un groupe de sans-abris qui a conscience de ses intérêts communs et qui peut assumer une espèce de conflictualité sociale. Je rêve que la littérature puisse encore créer des effets de théorie.
à découvrir
à découvrir



